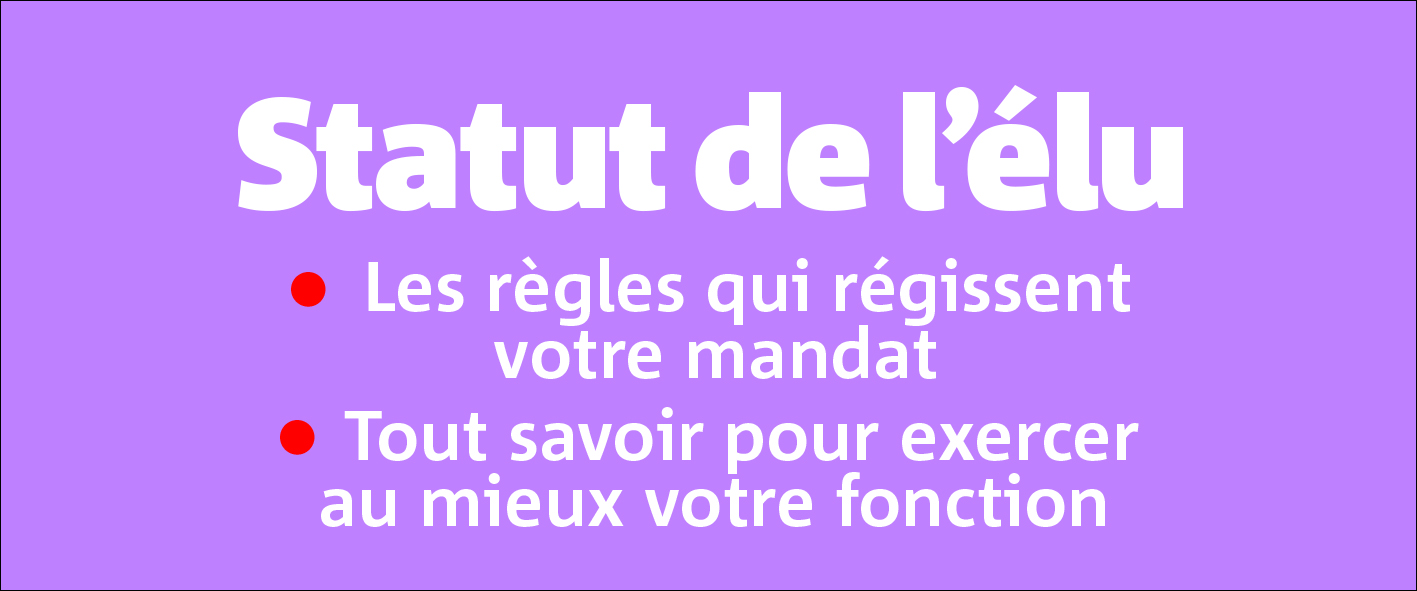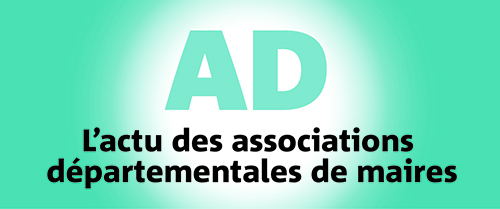Médiation : les maires ne peuvent pas tout régler
Interpellés par leurs administrés pour intervenir dans des conflits, le plus souvent de voisinage, les élus sont dans l'écoute pour désamorcer les tensions ou réorienter les personnes vers les bons interlocuteurs.

Pour Nathalie Perez-Leroux, maire de La Roque-Esclapon (245 habitants, Var), l’écoute est la première phase de la médiation et constitue déjà une bonne partie de la réponse aux problèmes : «c’est dire aux personnes : “je vous ai écoutés, je vous ai entendus et je vais voir ce que je peux mettre en œuvre”. »
Les élus constatent que si les habitants se tournent spontanément vers les maires, c’est parce qu’ils ont avant tout besoin de l’écoute d’une personne extérieure.
Le maire de Petit-Canal, en Guadeloupe (8 200 habitants), ...
La suite de l'article est réservée aux abonnés...
Déjà abonné ? Se connecter
 Accédez à tous les contenus de Maires de France en illimité
Accédez à tous les contenus de Maires de France en illimité
 Bénéficiez d’une offre de référence éditée par l’AMF
Bénéficiez d’une offre de référence éditée par l’AMF
 Choisissez le tarif qui vous correspond
Choisissez le tarif qui vous correspond
Cet article a été publié dans l'édition :
- Le dessin du mois de mars 2025. 2026 : un nouveau mandat ?
- Budgets 2025 : l'heure des choix difficiles
- Budget : les principales mesures de la loi de finances pour 2025
- Zan : vers un calendrier assoupli ?
- Accord sur la prévoyance: transposition législative en vue
- Améliorer l'accès aux fonds européens
- Développement local : concours
- Fonds européens : consultation sur le futur budget
- AMF 46 : campagne sur l'engagement local
- Municipales 2026 : échanges sur les règles préélectorales
- AMF 03 : aider les maires à annoncer un décès
- AMF 86 : réunion du " Club des parlementaires "
- AMM : voyage mémoriel en Pologne
- AMF 66 : 13e Salon des maires
- AMF 86 : salon, ateliers et échanges
- AMF 70 : territoires et habitants
- Andam : grand rendez-vous annuel
- Digues domaniales : les élus sur la brèche
- Emploi : l'EPCI préside le comité local
- L'enseignement musical au diapason intercommunal
- Municipales 2026 : candidat(e)s ou pas ?
- Logement : des pistes pour développer une offre abordable
- Sécurité : le Palais-sur-Vienne remet de l'humain sur le terrain
- Une IA pour aider les communes à rédiger leurs délibérations
- Il prend soin de la santé des habitants au quotidien
- Numérique : des services prêts à l'emploi pour les communes
- SACEM : comprendre les nouveaux forfaits
- Sécurité : les règles de la vidéoverbalisation
- Travailler avec... Les Papillons
- Électricité : passer au solaire
- Les relations entre les communes et les associations
- Conseils communautaires : attention aux délais pour 2026
- Titres d'identité : plusieurs évolutions importantes
- Obligation de télédéclaration des achats alimentaires
- Permanence des soins : le rôle des ARS
- Médiation : les maires ne peuvent pas tout régler
- Fin de mandat : quelques points à anticiper
- Le maire et Airbnb
Maires de France est le magazine de référence des maires et élus locaux. Chaque mois, il vous permet de décrypter l'actualité, de partager vos solutions de gestion et vous accompagne dans l'exercice de votre mandat. Son site Internet, mairesdefrance.com, vous permet d’accéder à toute l'information dont vous avez besoin, où vous voulez, quand vous voulez et sur le support de votre choix (ordinateur, tablette, smartphone, ...).