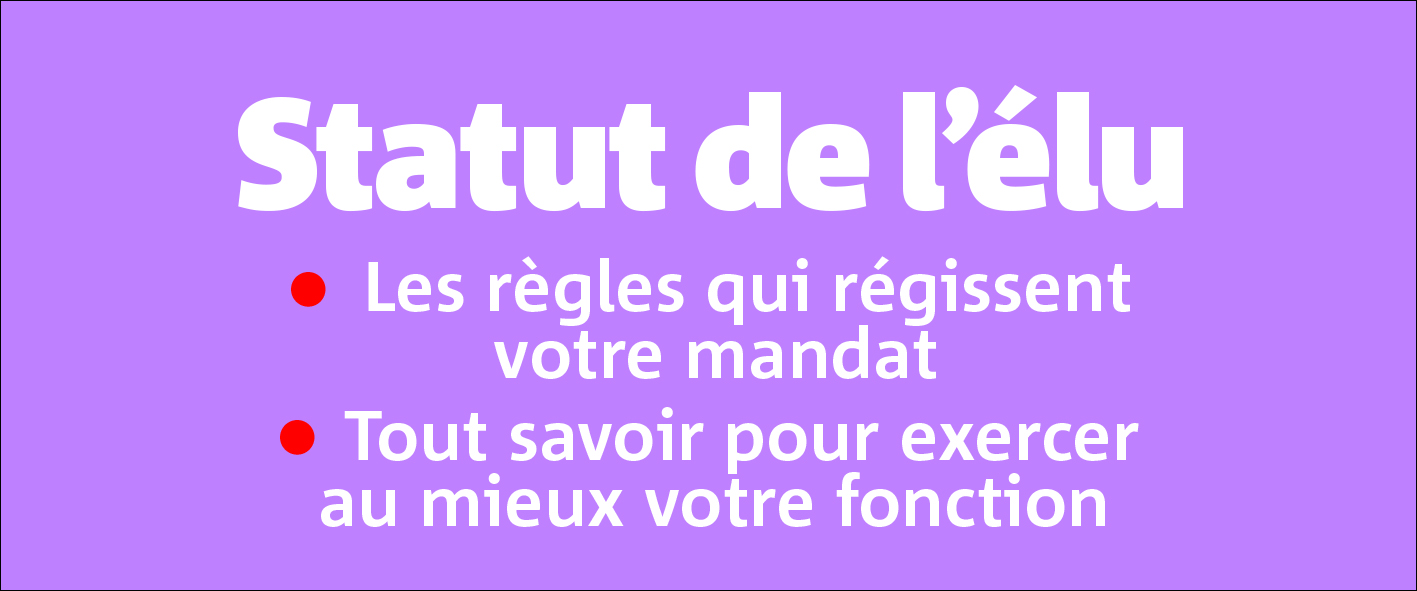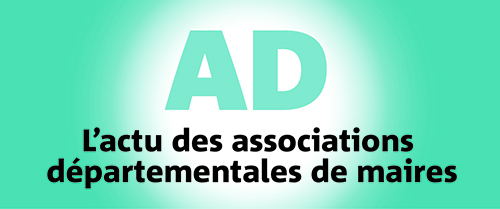27/07/2022
JUILLET-AOÛT 2022
- n°403
AMF Finances Sport
Sport : l'accès aux crédits reste une course d'obstacles
Le changement de gouvernance du sport en France avec la création, en 2019, de l'Agence nationale, des conférences régionales du sport et des conférences des financeurs auxquelles participent les collectivités locales, doit faciliter les cofinancements des projets et donc le montage des projets. La mise en place des instances territoriales a pris du retard.
Bénédicte Rallu

© S-OR
Les conférences des financeurs, issues des conférences régionales du sport, peuvent attribuer des crédits décentralisés pour développer la pratique sportive dans tout le pays.
objectifs : soutenir le sport de haut niveau en vue des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, développer la pratique sportive dans tout le pays.
Une gouvernance dorénavant partagée entre quatre acteurs (État, collectivités territoriales, mouvement sportif, monde économique et social) au niveau national, au sein de l’Agence. Et, au niveau local, dans les conférences régionales du sport (CRdS) et dans les conférences des financeurs (CF).
L’ANS étudie les gros projets structurants pour le pays et ceux qui sont au-delà d’un certain montant. Dans ces cas, les dossiers sont à déposer auprès de l’ANS. Les crédits (auparavant accordés par les ...
La suite de l'article est réservée aux abonnés...
Déjà abonné ? Se connecter
 Accédez à tous les contenus de Maires de France en illimité
Accédez à tous les contenus de Maires de France en illimité
 Bénéficiez d’une offre de référence éditée par l’AMF
Bénéficiez d’une offre de référence éditée par l’AMF
 Choisissez le tarif qui vous correspond
Choisissez le tarif qui vous correspond
Cet article a été publié dans l'édition :
n°403 - JUILLET-AOÛT 2022
- Incendies en Gironde : les premières leçons de la catastrophe
- Santé. Les urgences ne se limitent pas à l'été
- Politique de la ville : renforcer les marges de manoeuvre des collectivités
- Maires-justice : un partenariat à construire
- Énergie : l'Europe veut faire des économies et accélérer la transition
- Politique de cohésion : un ancrage territorial plus ferme ?
- Mission Climat : les collectivités françaises sélectionnées
- Accord européen sur le salaire minimum
- Politique de cohésion : en avant toute !
- Rapport sur la cohésion : la ruralité oubliée ?
- Budget de l'Union européenne 2023 : moteur de la relance
- Propagation terroriste en ligne : les règles relatives à leur suppression entrent en application
- AMF 26 - Gens du voyage
- AMF10 - Partenariat éditorial avec le Parquet
- AMF 15 - Des mobicartes pour les Ukrainiens
- ADM74 et ADM 86 - Règles de publicité des actes
- AMF46 - Justice de proximité
- AD23 - Carrefour des collectivités territoriales
- AMF77 - Congrès
- AMF - Séminaire des PAD
- ADM74 - Forum
- Tourisme de montagne : cap sur la diversification
- Loire : un réseau 100 % fibre optique
- La restitution partielle des compétences facultatives aux communes
- Taxe d'aménagement : attention aux délais pour délibérer !
- Sécurité civile : nouvelles obligations pour les EPCI
- Prise illégale d'intérêts : les élus insatisfaits
- Communes nouvelles : rendez-vous le 28 septembre 2022 !
- Finances : mise en ligne du montant du FPIC
- Sport : l'accès aux crédits reste une course d'obstacles
- Tester le plan communal de sauvegarde
- Beaumont crée une nappe phréatique artificielle
- Crolles soutient le spectacle vivant amateur
- Un maire audois sauve la tête de sa dernière chapellerie
- Les rave-parties, un cauchemar pour les élus de l'Hérault
- Bien préparer « sa » protection sociale complémentaire
- La mutualisation des caméras de vidéoprotection
- Travailler avec... Cotravaux
- Éclairage public : priorité aux économies
- La gestion des chemins ruraux
- Textes officiels - Plans communaux et intercommunaux de sauvegarde
- Textes officiels - Sport. Associations sportives et contrat d'engagement républicain
- Textes officiels - Aménagement. Procédure simplifiée de recours à l'expérimentation du Cerema
- Textes officiels - Correspondance des élus. Des documents administratifs communicables ou non ?
- Valeurs locatives des locaux professionnels : ce qu'il faut faire
- Jouets, outils, articles de sport : la filière de réemploi et de recyclage est lancée
- Danger, catastrophes : le dispositif FR-Alert est déployé
- Utiliser le procés-verbal électronique
- Retraite agricole : une issue favorable pour les élus
- Associations sportives et contrat d'engagement
- EPCI. Regards croisés de présidentes sur leur mandat
- La gestion de fait
- Le maire et le déminage
Les offres d’abonnement
Toutes les éditions
Maires de France est le magazine de référence des maires et élus locaux. Chaque mois, il vous permet de décrypter l'actualité, de partager vos solutions de gestion et vous accompagne dans l'exercice de votre mandat. Son site Internet, mairesdefrance.com, vous permet d’accéder à toute l'information dont vous avez besoin, où vous voulez, quand vous voulez et sur le support de votre choix (ordinateur, tablette, smartphone, ...).