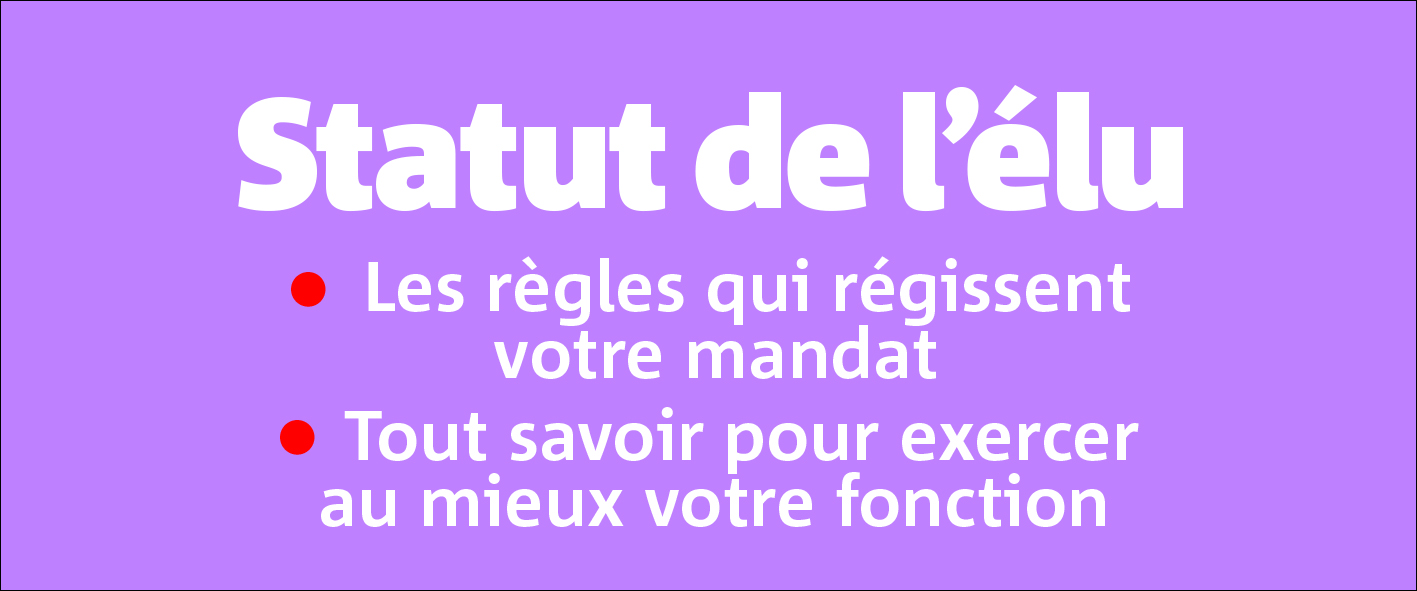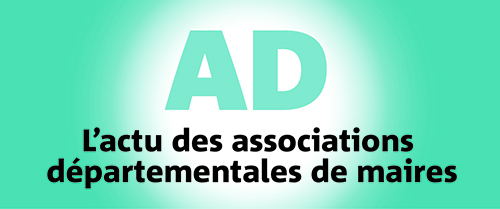Préserver la qualité de l'eau : un défi quotidien
Pesticides, nitrates, PFAS... Confrontés aux pollutions détectées sur leur territoire, des élus s'efforcent de protéger leurs captages et d'assurer la qualité de l'eau distribuée. Face à des traitements de plus en plus coûteux, ils tentent de privilégier une gestion préventive de la ressource.

Il raconte : «Nous avons été informés, fin 2023, par l’agence régionale de santé Grand-Est [ARS], à la suite de campagnes exploratoires qu’elle avait menées sur notre territoire, que trois de nos sites de captage d’eau présentaient des teneurs trop élevées en PFAS. Les analyses ont pointé une origine dont nous ignorions tout : ces PFAS proviennent en effet des mousses anti-incendie pourtant dûment certifiées et longtemps utilisées par les pompiers durant les exercices obligatoires qu’ils organisent sur l’aéroport international de Bâle-Mulhouse, proche de notre commune. »
Depuis l’annonce de cette pollution aux élus de l’agglomération, les décisions se sont enchaînées : fermeture d’un puits de captage dès 2023, mise en place d’un comité de pilotage coordonné par le sous-préfet de Mulhouse, information de la population. Et, sur le terrain, les solutions s’organisent : trois unités mobiles de filtration vont être louées d’ici à la fin 2025, avant la construction de trois stations de traitement par charbon actif, pour une enveloppe globale estimée à 20 millions d'euros. Des négociations sont en cours avec la plateforme aéroportuaire afin qu’elle cofinance ces travaux aux côtés de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse. Thierry Litzler souligne qu’« en 2025, il n’y aura pas d’augmentation du tarif de l’eau pour les abonnés ». Le vice-président de Saint-Louis Agglomération ne cache pas son inquiétude pour autant : «Nous devons échanger entre élus sur cette thématique et nous interroger sur les moyens mis en œuvre pour protéger nos zones de captage. »
PFAS : une ardoise salée
Même déflagration et semblables questionnements à Rumilly Terre de Savoie, lorsque cette communauté de communes apprend par l’ARS, fin 2022, que deux de ses ressources en eau sont polluées, là encore par des PFAS. «Ce fut un coup de massue, résume François Ravoire, président de cet EPCI de Haute-Savoie et maire de Vallières-sur-Fier. Face à une telle information, on se sent soudain seul et vraiment démuni, d’autant que les services de l’État ont découvert le problème en même temps que nous. »
La principale origine de ces polluants semble identifiée : ils proviendraient de l’usine produisant des poêles de la marque Tefal, établie à Rumilly. «Cette entreprise est liée à notre territoire depuis les années 1960. Tout le monde ici connaît quelqu’un qui travaille chez Tefal », souligne François Ravoire qui se souvient avoir, «en toute transparence », informé les habitants de la situation. «Comme nous ne pouvions plus distribuer cette eau polluée, nous avons dû en acheter au Grand-Annecy, poursuit-il. Puis nous avons lancé le projet d’une nouvelle unité de traitement aux charbons actifs. À notre grande surprise, une seule entreprise a répondu à notre appel d’offres. Mais il fallait agir face à cette urgence : fournir de l’eau à nos habitants. »
Cette nouvelle station de traitement, opérationnelle depuis 2024, a coûté 1,8 million d'euros. « L’État a pris en charge environ 20 %, le département 40 %, et notre communauté 40 %, détaille François Ravoire. Pour nous, c’est un lourd poids financier. Nous avons donc dû augmenter nos tarifs et passer de 1,80 €/m3 à 2,34 €/m3… Oui, c’est cher ! » L’entreprise Tefal a participé aux frais de renouvellement des filtres à charbons actifs. Mais, précise l’élu, cet effort financier n’a été consenti que pour 2024. «Tefal ne voulait pas être la seule entreprise à mettre la main à la poche car d’autres industriels ont, eux aussi, utilisé des PFAS sur notre territoire : une tannerie aujourd’hui fermée et le fabricant de skis Salomon, autrefois établi à Rumilly. » Mais de cette situation difficile, François Ravoire souhaite retenir un aspect positif : «Comme des pollutions aux PFAS sont découvertes un peu partout, les représentants d’autres territoires viennent désormais nous voir pour se renseigner. Aujourd’hui, avec notre expérience, nous pouvons les conseiller. »

La frustration des élus s’avère sans doute plus marquée lorsque l’origine de la pollution reste indéterminée. C’est la situation à laquelle est confronté Benoît Gouin, maire du Castellet (Alpes-de-Haute-Provence). En 2022, sa commune a été privée d’eau potable durant plus de quatre mois en raison de la présence d’un métabolite (sous-produit de pesticides) dans la source qui l’alimentait. Les 300 habitants se voient remettre des packs d’eau : ces distributions rythmeront longtemps la vie locale avant que le réservoir de la commune ne soit alimenté en eau potable par camion-citerne. Près de trois ans plus tard, le maire du Castellet attend toujours des réponses. «Notre source est encore polluée et nous ne savons toujours pas d’où provient cette pollution. L’enquête de l’ARS et les investigations de l’Office français de la biodiversité sont toujours en cours », explique-t-il.
À l’époque, plusieurs pistes sur l’origine de ces métabolites avaient été évoquées : celle d’une entreprise implantée près du Castellet et spécialisée dans le traitement de panneaux solaires, ainsi que des vergers situés, eux aussi, à proximité et dans lesquels des fongicides auraient été utilisés. «Mais nous ne sommes toujours sûrs de rien et nous avons très peu de retours de l’ARS », déplore Benoît Gouin, exaspéré par la longueur de l’enquête.
En charge des compétences eau et assainissement depuis 2013, Durance Luberon Verdon Agglomération (DVLA), à laquelle est rattaché le village du Castellet, espérait, d’abord, que cette crise serait passagère. Face à la persistance de la pollution, la régie de l’eau de DVLA a dû entreprendre, «en juin 2023, de créer des conduites à partir d’Oraison, un village situé à 6 km du nôtre et avec lequel nous sommes à présent interconnectés, explique Benoît Gouin. Ce chantier a coûté près d’1 million d'euros. S’agissant des travaux de captage qui avaient été réalisés pour notre source désormais inexploitée, ils ne servent aujourd’hui à rien… Pas plus que le terrain que notre commune avait acheté pour ce captage. »
Premier levier : sensibiliser les agriculteurs
Selon de récents chiffres du ministère de la Transition écologique, 53 % des eaux de surface et 39 % des eaux souterraines contiennent des résidus de pesticides. Ces chiffres ont sans doute incité l’État à présenter, fin mars, sa feuille de route sur la protection des captages d’eau potable qui donne la priorité à la «protection préventive » (lire notre article). «Une grande partie de nos ressources et de nos milieux naturels sont désormais pollués », déplore Christophe Lime, président de France Eau Publique, un réseau réunissant opérateurs publics et collectivités autour de la gestion de l’eau. Selon lui, «la philosophie de la gestion publique consiste à s’attacher au préventif plutôt qu’au curatif ». En la matière, les acteurs locaux disposent de quelques leviers et déjà, des élus concentrent leurs efforts sur l’amont, autrement dit sur la prévention de sources potentielles de pollution.
En tant que vice-président du Grand Besançon Métropole (GBM) chargé de la gestion de l’eau potable, des eaux fluviales et des eaux usées, Christophe Lime résume le dispositif mis en œuvre sur son territoire, lequel compte 32 captages d’eau : «Nous avons multiplié les contrats avec les acteurs de terrain : les agriculteurs, les industriels ou les collectivités. Nous cherchons toujours à anticiper, puis à établir un dialogue constructif sur le temps long. »
Premier levier, donc : sensibiliser les agriculteurs afin de stabiliser, voire de faire régresser la pollution liée à leurs activités. «Sur notre territoire, sont notamment produits du Comté et du Morbier, détaille Christophe Lime. De gros efforts ont été faits par ces producteurs, soutenus par l’agence de l’eau, pour travailler dans le respect de la terre, dans le cadre d’une agriculture raisonnée. Des parcelles ont été ramenées en prairie ou en bio. Pour les éleveurs fournissant du lait dit traditionnel, la situation s’avère plus compliquée car certains d’entre eux se trouvent en très grande difficulté économique. »
Et d’insister : selon lui, les élus doivent engager des discussions avec les agriculteurs. «Je vais à leur rencontre avec le maire de la commune concernée et un représentant de leur activité, par exemple un membre de la chambre d’agriculture. Je leur dis qu’en évoquant ce problème, nous les protégeons, eux aussi, de produits nocifs qui peuvent provoquer un cancer chez certains. »
Avec les acteurs industriels, le principe appliqué par GBM est identique : «Déterminer qui pollue, le rencontrer, le sensibiliser et faire évoluer ses process. Des diagnostics, financés par l’agence de l’eau, sont établis en fonction des activités industrielles afin de déterminer quels produits sont dangereux, puis trouver des alternatives. » Christophe Lime cite le cas des coiffeurs utilisant des produits chimiques, celui de la SNCF ayant recours aux désherbants sur ses lignes ferroviaires, les particuliers jetant des restes de peinture dans les égouts… Informer, donner des clés : dans le cadre d’une telle démarche, l’élu rappelle l’importance du journal municipal pour «mieux sensibiliser la population ».
Mais c’est avant tout avec le monde agricole que nombre de collectivités s’efforcent d’établir un dialogue constructif afin de faire évoluer les pratiques. Parmi ces acteurs locaux, citons le Syndicat mixte d’eau et d’assainissement du Caux Central (SMEACC), en Seine-Maritime : issu de la fusion, en 2013, de 8 syndicats, il regroupe 34 communes, soit environ 34 000 habitants. Gérard Legay, maire des Hauts-de-Caux et premier vice-président du SMEACC, se souvient de la première réunion qu’il a organisée avec les agriculteurs : «D’un côté se trouvaient les agriculteurs dits traditionnels et, de l’autre, ceux qui pratiquaient le bio ou les cultures raisonnées. Entre eux, la discussion était quasi-impossible. C’était en 2010. Aujourd’hui, ils travaillent ensemble. »
Faire évoluer les pratiques agricoles
Certes, souligne Gérard Legay, de tels échanges ont aidé les agriculteurs à faire évoluer leurs pratiques. Mais de nombreux problèmes de produits polluants persistent. «Sur notre territoire, la disparition de l’élevage au profit de cultures industrielles entraîne une perte de l’herbage, lequel représente un des filtres les plus efficaces », déplore l’élu. «Cette évolution constitue un réel problème, confirme Géraldine Lemaistre, directrice du SMEACC. L’agence de l’eau nous a donc proposé de mettre en place le paiement pour services environnementaux. Encadré par l’Europe, ce dispositif permet de rémunérer une activité agricole favorable à l’environnement. Dans notre cas, il s’adresse aux agriculteurs qui maintiennent des prairies ou remettent de l’herbe dans les champs où nous rencontrons des problèmes de ravines qui alimentent nos bétoires (NDLR : petit entonnoir naturel). » Ces bétoires forment en effet des points d’infiltration pour les eaux de surface vers les eaux souterraines, permettant ainsi aux produits polluants de gagner la nappe.

Le SMEACC a donc intensifié ses efforts sur le traitement des eaux en aval. «Une nouvelle usine, mise en service en 2022, traite les problèmes de turbidité et de pesticides et assure une décarbonatation », détaille Gérard Legay, qui souligne toutefois que «cette usine a coûté 7 millions d'euros. Sans le SMEACC, il aurait été pour nous impossible de mener un tel projet. » Et, selon cet élu, les collectivités locales devront continuer à investir : «On découvre sans cesse de nouvelles molécules qui nécessiteront peut-être d’adapter encore nos usines de traitement ou d’en créer… »
Une analyse partagée au sein de Rumilly Terre de Savoie par François Ravoire : «Nous sommes nombreux à penser que plus nous allons chercher de micro-polluants, plus nous allons en trouver. » Or, le curatif n’est pas sans coûts environnementaux ; les process sont lourds sur le plan énergétique, et coûteux.
Comment dès lors parvenir à la réduction des pollutions, en passant d’une logique curative à une démarche préventive ? Le sujet sera l’un des thèmes des conférences territoriales sur l’eau lancées, le 7 mai, par le Premier ministre, et qui se tiendront de juin à octobre 2025 en concertation notamment avec les élus locaux. Objectifs : lever les points de blocage, capitaliser les bonnes pratiques «et procéder aux ajustements réglementaires voire législatifs à mener pour accélérer ou compléter les démarches en cours ».
.jpg)
Franco Novelli, expert technique et directeur adjoint du département cycle de l’eau à la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR)
« La qualité de l’eau pèse toujours plus sur les collectivités »
Raccourci : mairesdefrance.com/28540
Cet article a été publié dans l'édition :
- AMF 72. Secrétaires généraux de mairie
- Le dessin du mois de juin 2025
- Finances. Les élus critiquent le calcul du Dilico
- Comptes publics : désaccords entre l'État et les élus
- Carte scolaire : une coopération avant toute évolution
- Santé : le gouvernement propose un «pacte» contre les déserts médicaux
- Cohésion : le Parlement européen exprime ses attentes
- AMF 49. Missions culturelles
- AMF 77. Accueillir les étudiants en médecine
- AMF 02. Réunions avec le centre de gestion
- AMF 46. Annonce d'un décès
- Sécurité des ponts : le financement pose question
- Le Pays de Thiérache (Aisne) lutte contre le gaspillage alimentaire
- Transformer une ancienne friche en levier économique
- Préserver la qualité de l'eau : un défi quotidien
- Santé mentale. Trois initiatives pour améliorer la prise en charge
- Le Port emploie des jeunes en service civique solidarité seniors
- Opération stérilisation de chats errants
- Il accueille le Tour de France
- Cybersécurité : trouver les bons interlocuteurs
- Surveiller l'exposition aux ondes électromagnétiques
- Eau et assainissement : délégation et mutualisation des compétences
- Risques inondations : de nouveaux outils pour les maires
- Débroussaillement : faire respecter les obligations
- Secrétaires généraux de mairie : tout savoir sur leur statut
- Espaces publics : aide à la location
- Journée nationale de la résilience : appel à projets
- Santé mentale : les ressources pour les élus et les agents
- La communication institutionnelle en période préélectorale
- Administration : délivrance des certificats de décès par les infirmiers
- Cirques : demandes d'occupation du domaine public
- Municipales 2026 : généralisation du scrutin de liste paritaire
- Transports : renforcement de la sécurité
- Est-il encore possible de solliciter les fonds européens ?
- Quel est le délai pour élaborer un plan intercommunal de sauvegarde ?
- Est-il possible de recruter un contractuel pour remplacer l'absence d'un agent permanent ?
- Municipales 2026 : anticiper le passage de flambeau
- La réinsertion professionnelle après le mandat
- Le maire et le souverain pontife
Maires de France est le magazine de référence des maires et élus locaux. Chaque mois, il vous permet de décrypter l'actualité, de partager vos solutions de gestion et vous accompagne dans l'exercice de votre mandat. Son site Internet, mairesdefrance.com, vous permet d’accéder à toute l'information dont vous avez besoin, où vous voulez, quand vous voulez et sur le support de votre choix (ordinateur, tablette, smartphone, ...).