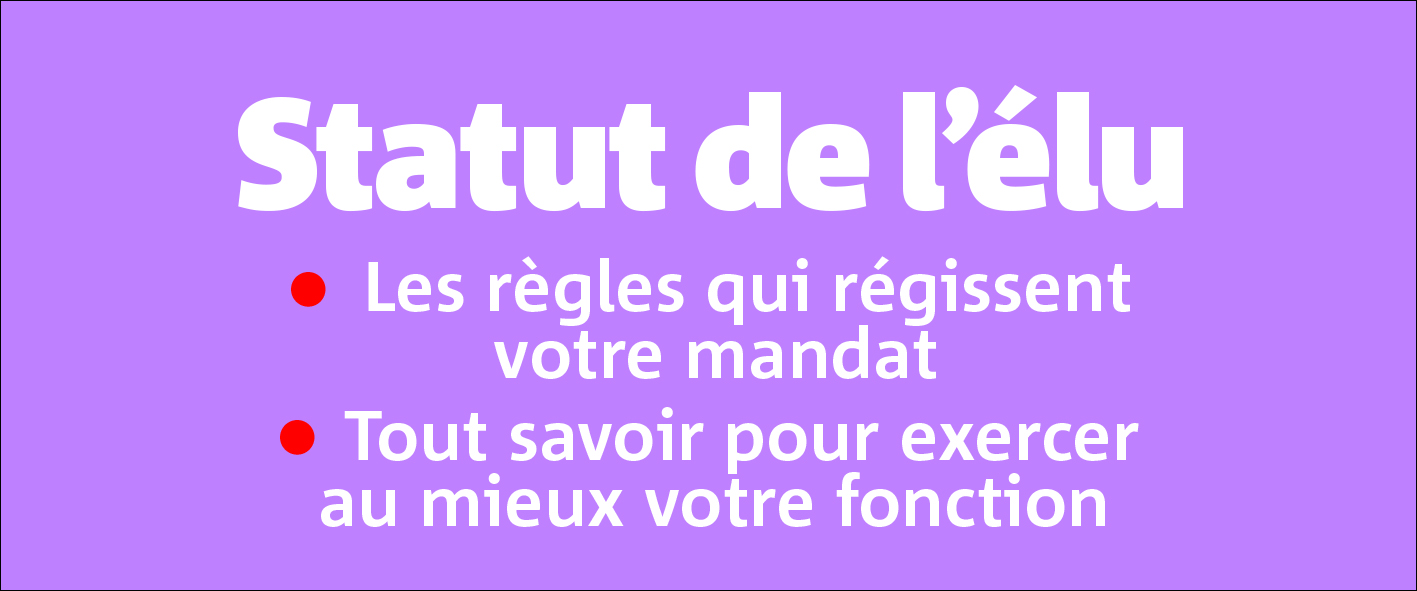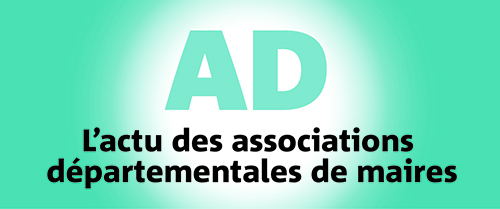22/12/2022
DÉCEMBRE 2022
- n°407
Marchés publics
Commande publique : les outils anti-crise
L'envolée des prix et les difficultés d'approvisionnement percutent les règles de la commande publique. Des moyens permettent d'assurer la continuité du service public.
Par Bénédicte Rallu

© AdobeStock
La suite de l'article est réservée aux abonnés...
Déjà abonné ? Se connecter
 Accédez à tous les contenus de Maires de France en illimité
Accédez à tous les contenus de Maires de France en illimité
 Bénéficiez d’une offre de référence éditée par l’AMF
Bénéficiez d’une offre de référence éditée par l’AMF
 Choisissez le tarif qui vous correspond
Choisissez le tarif qui vous correspond
Raccourci : mairesdefrance.com/1859
Cet article a été publié dans l'édition :
n°407 - DÉCEMBRE 2022
- « L'entreprise doit justifier ses augmentations de prix»
- Incendies, sécheresse : gérer la forêt autrement
- Comment les fractions de TVA revenant aux EPCI sont-elles actualisées en 2022 ?
- Développement économique : les EPCI en pole position
- Finances : les chiffres clés du bloc local
- L'AMF oppose une fin de non-recevoir à la Cour des comptes
- Pactes financiers et fiscaux : l'AMF vous aide
- Isère : un contrat dédié à la santé « globale »
- Hommage à l'action des associations départementales
- Adapter la politique du logement aux spécificités de la commune
- La Ricamarie pratique le " Sport dans la ville "
- Le Haillan (Gironde) s'engage pour préserver le bien vivre
- Patrimoine : mettre en valeur son cimetière
- Il sauve l'épicerie multiservices de la commune
- Commande publique : les outils anti-crise
- Vendre ou donner des biens mobiliers : quelle procédure ?
- La responsabilité financière des gestionnaires publics
- Risques : mode d'emploi du dispositif Fr-Alert
- Sécurité routière. Vitesse sous surveillance
- Services publics : les relations collectivités-délégataires
- Textes officiels - Énergie : un guichet pour le chèque exceptionnel en faveur des ménages modestes
- Textes officiels - École : une circulaire face à la montée des atteintes à la laïcité
- Textes officiels - Prélèvement sur fiscalité au titre du redressement des finances publiques
- Textes officiels - Entreprises publiques locales : contenu du rapport annuel que les élus mandataires doivent présenter
- La REP Bâtiment entre en vigueur au 1er janvier 2023
- Publicité lumineuse : extinction
- Énergie : recours contre les projets
- Fonction publique territoriale : conditions d'éligibilité du complément de traitement indiciaire (CTI)
- Caméras : nouvelles règles pour les policiers municipaux
- FR-Alert : le rôle du maire
- Correspondant incendie et secours au 1er novembre 2022 : rappel des règles
- Gestion des conflits internes : une mission délicate pour les élus
- Le délit de concussion
- Le maire et le polissoir
Les offres d’abonnement
Toutes les éditions
Maires de France est le magazine de référence des maires et élus locaux. Chaque mois, il vous permet de décrypter l'actualité, de partager vos solutions de gestion et vous accompagne dans l'exercice de votre mandat. Son site Internet, mairesdefrance.com, vous permet d’accéder à toute l'information dont vous avez besoin, où vous voulez, quand vous voulez et sur le support de votre choix (ordinateur, tablette, smartphone, ...).