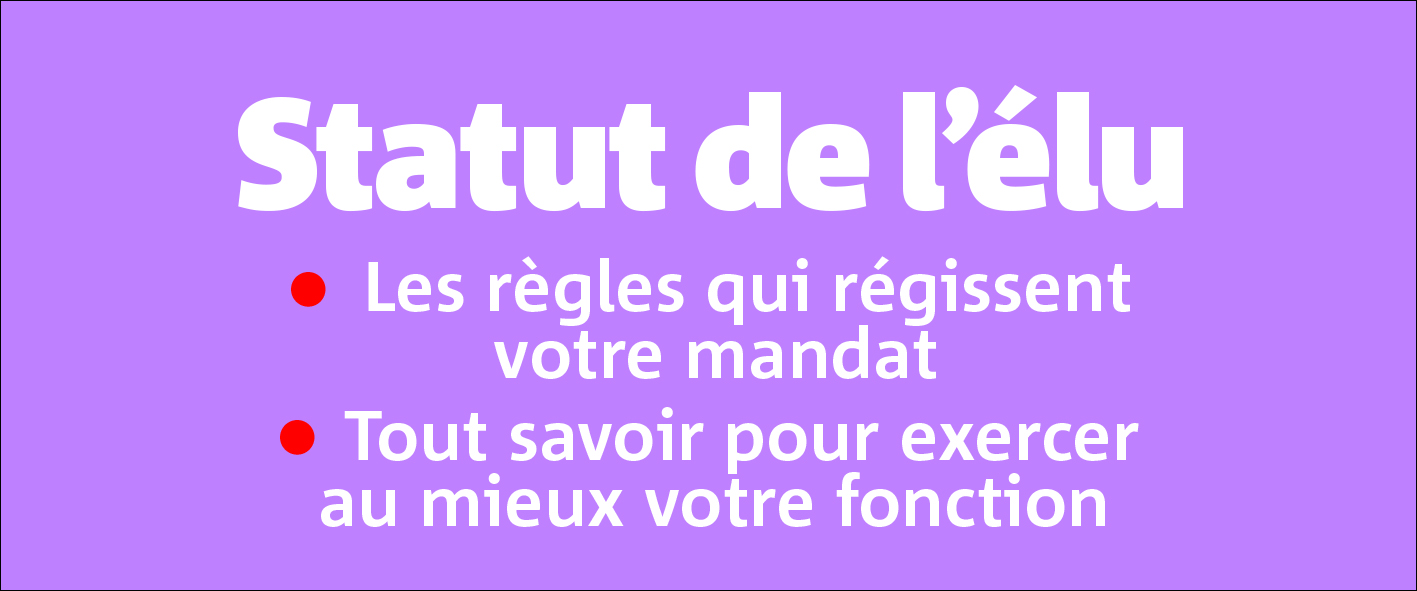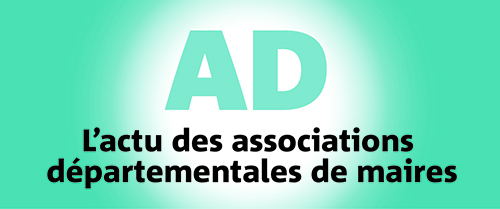La communication institutionnelle en période préélectorale
À partir du 1er septembre 2025, il faut distinguer la communication institutionnelle, autorisée, des actions susceptibles d'être qualifiées de propagande électorale.

I - Quelles sont les règles ?
1 Les limites légales
La communication institutionnelle peut et doit même continuer à l’approche du scrutin : il est en effet de la responsabilité de la collectivité de tenir les administrés informés des actions entreprises et de l’utilisation des deniers publics. Cette communication institutionnelle doit néanmoins être strictement limitée à la délivrance d’informations neutres et justifiées par l’actualité.
. Pas de promotion publicitaire. Le Code électoral interdit en effet toute «campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité » (article L. 52-1 alinéa 2) à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois de l’élection (soit le 1er septembre 2025 pour les prochaines élections municipales et communautaires). Derrière cette notion, qui n’est pas immédiatement compréhensible et qui n’est pas définie par la loi, il faut comprendre qu’il y a campagne de promotion dès lors que l’initiative de communication dépasse l’information classique pour devenir un instrument de promotion des réalisations d’une collectivité et de ses élus.
L’exposé des motifs d’une proposition de loi portant modification de l’article L. 52-1 du Code électoral (Sénat, séance du 26 octobre 2000) précisait que «le législateur a voulu viser la promotion publicitaire “institutionnelle” », c’est-à-dire celle résultant de publications diverses, écrites et audiovisuelles notamment, financées sur des fonds publics par les collectivités locales concernées. Le champ d’application de cette interdiction s’étend à tous les supports de communication, qu’ils soient internes ou externes, qu’il s’agisse du bulletin d’information général ou du site internet de la collectivité, des réseaux sociaux, d’affiches et de photographies, de cartes de visites ou de courrier. Il s’étend aussi aux événements organisés par la commune.
À noter : seuls les candidats peuvent effectuer de telles campagnes de promotion, à leur frais, comme l’indique expressément le deuxième alinéa de l’article L. 52-1 du Code électoral. Dans le strict cadre de sa campagne électorale, l’élu candidat peut effectivement présenter de manière élogieuse le bilan de la gestion du mandat qu’il détient ou qu’il a détenu.
. Cas de jurisprudence. Le juge administratif a considéré que constituent une campagne prohibée des initiatives nombreuses et répétées mettant en valeur l’action de la collectivité, comprenant une intensité accrue de la publication du magazine municipal, quatre numéros spéciaux consacrés à mettre en valeur l’action municipale, dont le bilan de la municipalité, des inaugurations réitérées (CE, 10 juillet 2009, élections municipales de Briançon, n° 322070).
En revanche, le Conseil d’État a écarté la qualification de campagne de promotion publicitaire s’agissant de l’organisation de manifestations se rattachant à des événements particuliers, ne bénéficiant pas d’une couverture médiatique particulière et ne contribuant pas à la promotion des réalisations et de la gestion de la commune (CE, 17 avril 2015, élections municipales d’Audenge, n° 382194).
. Les dons de personnes morales interdits. La méconnaissance de l’article L. 52-1 du Code électoral entraînera souvent la méconnaissance de l’article L. 52-8 du même code portant interdiction des dons des personnes morales (à l’exception des partis ou groupements politiques) pour financer une campagne électorale (et ce, quelle que soit la taille de la collectivité). En effet, en organisant une action de communication constituant en réalité de la propagande électorale en faveur des élus majoritaires sortants, la collectivité va mobiliser des fonds (conception, salaires des personnels ou paiement des prestataires sollicités pour la réalisation, l’impression, la distribution, la location de la salle et le traiteur s’il s’agit d’un événement...) qui profitent à la campagne des candidats issus de ce camp. Par exception néanmoins, certaines communications ne sont pas valorisables (rédaction d’un tweet ou d’un post sur un réseau social, par exemple).
2 L’interprétation du juge électoral
. Faisceau d’indices. Les notions de campagne de promotion et de don prohibé sont appréciées au cas par cas par le juge de l’élection au regard d’un faisceau d’indices qui se compose de trois critères principaux : l’antériorité (caractère habituel et traditionnel de l’action de communication), l’identité (absence de modification de la forme et de la fréquence du support ou de l’événement) et, surtout, la neutralité du contenu (messages ou discours politiquement neutres, à caractère purement informatif).
Il faut souligner qu’il s’agit d’indices et non de critères cumulatifs, ce qui veut dire que le fait qu’ils ne soient pas réunis simultanément n’empêche pas le juge de considérer qu’il se trouve en présence d’une campagne prohibée.
. Cas de jurisprudence. À titre d’illustration, le fait qu’une publication bénéficie du critère d’antériorité ne suffit pas à lui éviter d’être qualifiée de campagne prohibée dès lors qu’elle dresse un bilan particulièrement favorable de l’action des élus ou encore que sa pagination habituelle est substantiellement modifiée (CE, 6 mai 2015, élections municipales d’Ailly-sur-Noye, n° 383305).
De même, «eu égard à la nature et à l’ampleur [d’opérations de communication], la circonstance qu’elles ont été précédées de campagnes similaires les années antérieures et présentent ainsi un caractère récurrent n’est pas de nature […] à leur retirer le caractère de campagnes de promotion publicitaire prohibées » et ce, même si le message délivré n’était pas manifestement laudatif à l’égard de la majorité sortante : le fait qu’il soit programmatique et qu’il rencontre des thèmes de campagne des candidats qui en étaient issus, couplé à l’importance de la campagne de communication, suffit à conférer à celle-ci le caractère de propagande électorale (CE Ass., 4 juillet 2011, élections régionales d’Île-de-France, n° 338033).
À noter : il est primordial de relever que le contenu du message et donc l’indice de neutralité prévaudra dans l’appréciation faite par le juge de l’élection. Il convient donc d’éviter toute personnalisation du message valorisant les élus candidats ou l’emploi de superlatifs pour qualifier les réalisations de la collectivité.
II - Quels risques pour les collectivités et leurs élus ?
1 Les risques électoraux
La méconnaissance de l’article L. 52-1 alinéa 2 comme de l’article L. 52-8 du Code électoral peut entraîner l’annulation du scrutin en cas de protestation électorale et si elle a pu (seule ou conjointement à d’autres irrégularités) altérer la sincérité du scrutin, c’est-à-dire si le juge électoral estime qu’elle a pu jouer un rôle déterminant dans le résultat du vote.
2 Les risques financiers
Dans les communes de plus de 9 000 habitants – pour lesquelles l’élection est soumise à l’obligation de présentation d’un compte de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP, lire ci-contre) –, si la réintégration du montant des dons prohibés dans le compte de campagne a pour effet de causer un dépassement du plafond des dépenses électorales ou si la méconnaissance de l’article L. 52-8 du Code électoral constitue une irrégularité particulièrement grave, la CNCCFP pourra décider de rejeter le compte de campagne, ce qui entraînera la saisine du juge de l’élection. Le constat de telles irrégularités amènera la réintégration de la contre-valeur de l’avantage consenti au candidat dans son compte de campagne, le versement du montant de l’éventuel dépassement du plafond des dépenses électorales au Trésor public et la suppression du remboursement forfaitaire des dépenses électorales par l’État.
3 Les risques pénaux
La méconnaissance des articles L. 52-1 alinéa 2 et L. 52-8 du Code électoral peut aussi entraîner certaines conséquences pénales, tant pour la collectivité auteur de la campagne de promotion et du don prohibé que pour les candidats qui en ont bénéficié. En effet, l’auteur de la campagne peut être puni d’une amende de 75 000 euros, aux termes de l’article L. 90-1 du Code électoral.
Le candidat pourra être condamné à une peine d’emprisonnement (3 ans maximum) et/ou d’amende (45 000 euros maximum) en application de l’article L. 113-1 du Code électoral. En outre, en cas de volonté de fraude ou d’un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, il s’expose à une peine d’inéligibilité (article L. 118-3 du Code électoral).
Raccourci : mairesdefrance.com/28554
Cet article a été publié dans l'édition :
- AMF 72. Secrétaires généraux de mairie
- Le dessin du mois de juin 2025
- Finances. Les élus critiquent le calcul du Dilico
- Comptes publics : désaccords entre l'État et les élus
- Carte scolaire : une coopération avant toute évolution
- Santé : le gouvernement propose un «pacte» contre les déserts médicaux
- Cohésion : le Parlement européen exprime ses attentes
- AMF 49. Missions culturelles
- AMF 77. Accueillir les étudiants en médecine
- AMF 02. Réunions avec le centre de gestion
- AMF 46. Annonce d'un décès
- Sécurité des ponts : le financement pose question
- Le Pays de Thiérache (Aisne) lutte contre le gaspillage alimentaire
- Transformer une ancienne friche en levier économique
- Préserver la qualité de l'eau : un défi quotidien
- Santé mentale. Trois initiatives pour améliorer la prise en charge
- Le Port emploie des jeunes en service civique solidarité seniors
- Opération stérilisation de chats errants
- Il accueille le Tour de France
- Cybersécurité : trouver les bons interlocuteurs
- Surveiller l'exposition aux ondes électromagnétiques
- Eau et assainissement : délégation et mutualisation des compétences
- Risques inondations : de nouveaux outils pour les maires
- Débroussaillement : faire respecter les obligations
- Secrétaires généraux de mairie : tout savoir sur leur statut
- Espaces publics : aide à la location
- Journée nationale de la résilience : appel à projets
- Santé mentale : les ressources pour les élus et les agents
- La communication institutionnelle en période préélectorale
- Administration : délivrance des certificats de décès par les infirmiers
- Cirques : demandes d'occupation du domaine public
- Municipales 2026 : généralisation du scrutin de liste paritaire
- Transports : renforcement de la sécurité
- Est-il encore possible de solliciter les fonds européens ?
- Quel est le délai pour élaborer un plan intercommunal de sauvegarde ?
- Est-il possible de recruter un contractuel pour remplacer l'absence d'un agent permanent ?
- Municipales 2026 : anticiper le passage de flambeau
- La réinsertion professionnelle après le mandat
- Le maire et le souverain pontife
Maires de France est le magazine de référence des maires et élus locaux. Chaque mois, il vous permet de décrypter l'actualité, de partager vos solutions de gestion et vous accompagne dans l'exercice de votre mandat. Son site Internet, mairesdefrance.com, vous permet d’accéder à toute l'information dont vous avez besoin, où vous voulez, quand vous voulez et sur le support de votre choix (ordinateur, tablette, smartphone, ...).