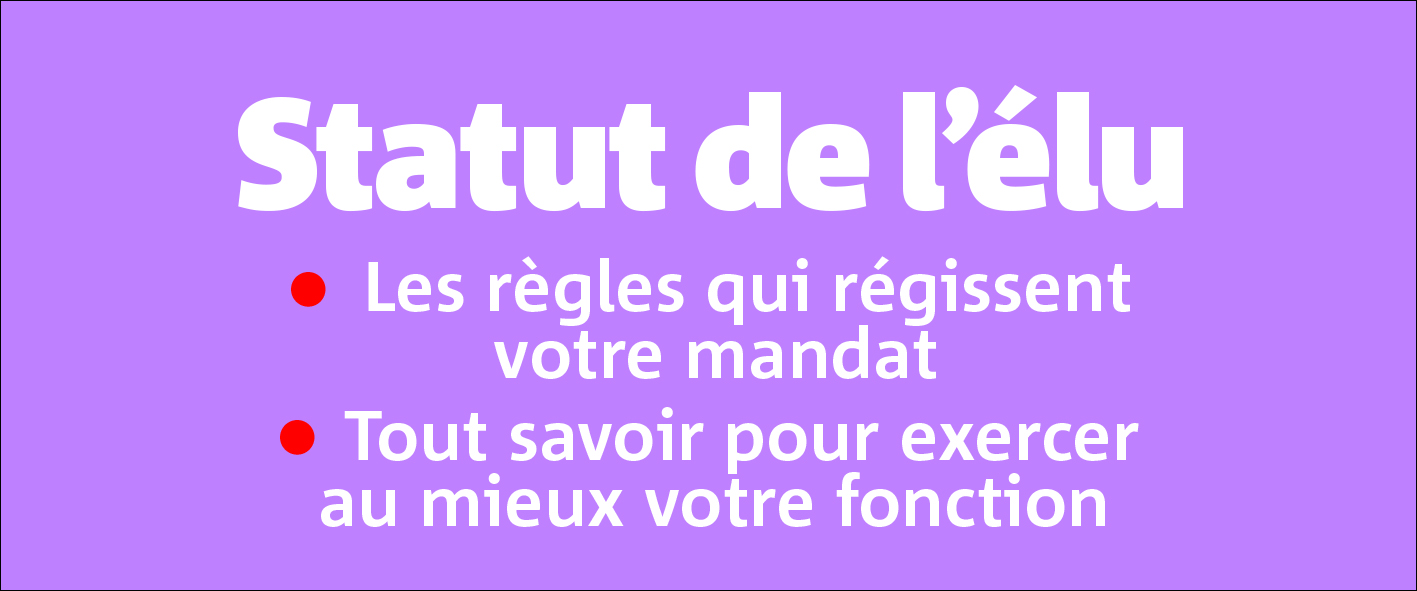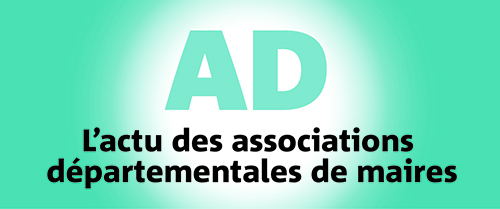04/10/2023
JUIN 2023
- n°413
Administration générale Transports, mobilité, voirie
Les polices de la circulation et du stationnement
La répartition des compétences entre le maire, le président de l'EPCI et les autres acteurs en matière de police sur les voies publiques est complexe.
Fabienne Nedey, avec Louise Larcher et Jeff Chopy

© Adobestock
Ces polices n’ont pas les mêmes finalités ni les mêmes fondements. Elles peuvent relever de la compétence unique ...
La suite de l'article est réservée aux abonnés...
Déjà abonné ? Se connecter
 Accédez à tous les contenus de Maires de France en illimité
Accédez à tous les contenus de Maires de France en illimité
 Bénéficiez d’une offre de référence éditée par l’AMF
Bénéficiez d’une offre de référence éditée par l’AMF
 Choisissez le tarif qui vous correspond
Choisissez le tarif qui vous correspond
Raccourci : mairesdefrance.com/2218
Cet article a été publié dans l'édition :
n°413 - JUIN 2023
- Aménagement. Préserver le foncier productif agricole
- Nouvelles brigades de gendarmerie: les élus s'interrogent
- France Travail. Quelle place pour les acteurs locaux de l'emploi ?
- AMF 46 - Journée identité numérique
- AMA - Zoom sur les correspondants incendie et secours
- ADM 64 - Lutte contre la violence à l'école
- AMF 05 - Soutien psychologique des élus
- AMF 21 - Rencontre avec les nouveaux maires
- AD 35 - Salon Terres&maires
- AD 51 - Carrefour des collectivités
- AD 67 - Salon
- Accessibilité : la France doit mieux faire
- Fonds européens. La région Bourgogne-Franche-Comté informe les maires
- Leader 2014-2022 : il reste des crédits !
- Green deal : valoriser les initiatives locales
- Développement rural : mise en place des GAL
- Erasmus : la France plébiscite le programme
- Eau et assainissement : les élus préparent le transfert
- La métropole européenne de Lille construit une autoroute de la chaleur
- Communauté de communes Flandre Lys. CIAS, un levier pour de nouvelles actions sociales
- À Vire Normandie (Calvados), un musée à hauteur d'enfant
- Avec la fibre, Pleaux retrouve de la vitalité
- Sécheresse : un élu sarthois plaide la cause des habitants
- Dix conseils pour assurer sa sécurité numérique
- Feux de forêt : faire respecter les obligations de débroussaillement aux habitants
- Patrimoine : recenser les objets culturels communaux pour mieux les protéger
- Travailler avec Lire et faire lire
- Patrimoine bâti. Les soutiens pour le restaurer
- Les polices de la circulation et du stationnement
- Référents déontologues : nomination
- Amortisseur électricité : l'attestation est repoussée au 30 juin 2023
- Gens du voyage : gestion des grands passages
- Le maire peut-il renoncer à célébrer un mariage en cas de débordements ?
- Une commune ou un EPCI doivent-ils tenir un répertoire d'informations publiques ?
- Feux d'artifice : quelle est la règlementation ?
- Feux de forêt : une instruction mobilise les acteurs locaux avant l'été 2023
- Une loi valide la fusion des filières REP emballages ménagers et papiers
- Sport. Extension de la pratique au collège dès septembre
- Jeux olympiques et paralympiques 2024. Plan d'action pour l'animation territoriale
- Intercommunalité : le blues des "petits" maires
- Le remplacement des conseillers communautaires
- Le maire et la restitution
Les offres d’abonnement
Toutes les éditions
Maires de France est le magazine de référence des maires et élus locaux. Chaque mois, il vous permet de décrypter l'actualité, de partager vos solutions de gestion et vous accompagne dans l'exercice de votre mandat. Son site Internet, mairesdefrance.com, vous permet d’accéder à toute l'information dont vous avez besoin, où vous voulez, quand vous voulez et sur le support de votre choix (ordinateur, tablette, smartphone, ...).