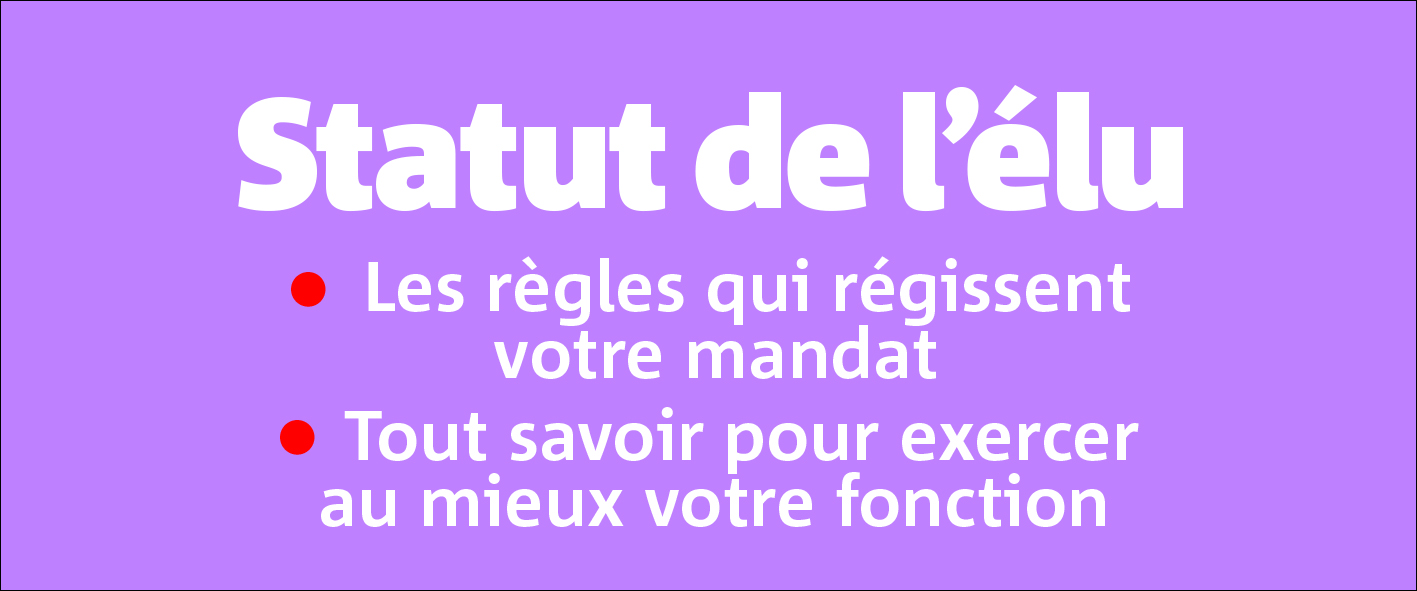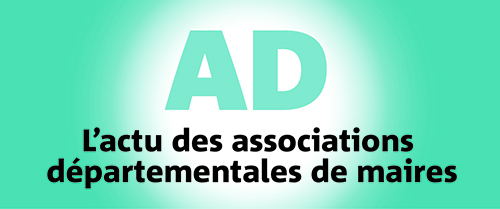10/11/2023
OCTOBRE 2023
- n°416
Energie Environnement
Gérer l'éclairage public dans sa commune
L'éclairage public est un gouffre énergétique. Sa modernisation permet de réaliser des économies tout en améliorant sa qualité.
Par Fabienne Nedey

© AdobeStock
Deux milliards d'euros sont chaque année dépensés dans l'éclairage urbain en France, dont 1 milliard d'euros consacré uniquement à la
maintenance. Source : Association française de l'éclairage, 2019.
Elle a publié, avec le Syndicat de l’éclairage, un guide pour aider les maires à agir. Seuls 15 % seulement des 11 millions de lampadaires sont des leds. Or, la modernisation de l’éclairage public, incluant la maintenance, pourrait potentiellement représenter 50 à 80 % d’économies d’énergie pour les collectivités. Mais il ne s’agit pas «que » de remplacer les ampoules, d’opter pour des coupures ou pour une extinction pure et simple de l’éclairage nocturne.
La rénovation de l’éclairage soulève des enjeux technologiques et environnementaux. Les communes peuvent développer un éclairage intelligent. ...
La suite de l'article est réservée aux abonnés...
Déjà abonné ? Se connecter
 Accédez à tous les contenus de Maires de France en illimité
Accédez à tous les contenus de Maires de France en illimité
 Bénéficiez d’une offre de référence éditée par l’AMF
Bénéficiez d’une offre de référence éditée par l’AMF
 Choisissez le tarif qui vous correspond
Choisissez le tarif qui vous correspond
Raccourci : mairesdefrance.com/2381
Cet article a été publié dans l'édition :
n°416 - OCTOBRE 2023
- Des ballots de drogue s'échouent sur le littoral de Réville (Manche)
- AMF 26 - Prévention des attaques de loup
- André Laignel : La recentralisation et la baisse des moyens des collectivités se sont aggravées
- Statut de l'élu : des propositions fortes à venir
- Écoles. Un peu d'argent et des inquiétudes
- Les principaux rendez-vous des adhérents de l'AMF
- Fonction publique : ce qui a changé
- Présence postale : tout savoir sur le contrat 2023-2025
- Quels sont les enjeux des JOP 2024 pour les communes ?
- AD 79 et AD 86 - Secrétaires de mairie : formation diplômante
- AMG 33 - Sensibiliser à la gestion de crise
- AMI 36 - Soutien aux élus victimes d'agressions
- AMF 01 - Mobilisation pour la démocratie
- AMF 42 - Congrès départemental
- ADM 06 - Salon
- ADM 74 - Forum des collectivités territoriales
- Accélérer le déploiement des réseaux très haut débit
- Protection du loup : faut-il l'alléger ?
- Nouvelle élue française au Comité des régions de l'Union européenne
- Nouvelle directive sur les économies d'énergie
- Le 105e Congrès de l'AMF sera aussi à l'heure européenne
- Lutter contre les stéréotypes sexistes
- Jeunes agriculteurs. Faciliter leur installation
- Hauts-de-France. Concertations sur les trains
- Gens du voyage : la valeur ajoutée d'un syndicat mixte entre EPCI
- La gestion des digues domaniales
- Présence postale. Le rôle clé des commissions départementales
- Patrimoine. Animer les lieux de mémoire
- Quand le CCAS et France services ne font qu'un
- Des sauveteurs bénévoles en renfort des pompiers
- Brains opte pour une piscine mobile
- Il crée une réserve communale de sécurité civile
- Gérer l'éclairage public dans sa commune
- Police de la publicité : les modalités du transfert aux intercommunalités
- Communication-création : choisir la bonne procédure de consultation
- Dématérialisation des demandes d'urbanisme : ce qu'il faut faire
- Travailler avec le CAUE
- Énergie. Cap sur l'hydrogène vert
- Terre de jeux 2024 : la vente de billets prolongée
- Programme AVELO, c'est parti !
- Référent déontologue : s'informer
- SOS Ponts : un service d'assistance en ligne
- Utiliser le PV électronique
- Zéro artificialisation nette (ZAN) : des règles facilitatrices
- " Pass'sport " : prolongation en 2023
- Résidences secondaires : majoration de la taxe d'habitation
- Pompiers volontaires. Dons de jours de repos
- Trottinettes : nouvelle réglementation
- Gardes champêtres. Tenues et véhicules
- Comment reprendre une concession funéraire en état d'abandon ?
- Quelles sont les nouvelles mesures relatives à la retraite des élus locaux depuis le 1er septembre 2023 ?
- Un maire peut-il refuser d'accueillir un cirque avec des animaux sauvages ?
- Administration. Le statut et les missions des directeurs d'école précisés
- Emeutes. Publication des ordonnances relatives à la reconstruction des biens dégradés
- Administration. Le statut et les missions des directeurs d'école précisés
- Environnement. Réutilisation des eaux usées
- Gérer un mouvement social
- Protection des élus : les nouvelles mesures du plan national
- Le maire et l'église
Les offres d’abonnement
Toutes les éditions
Maires de France est le magazine de référence des maires et élus locaux. Chaque mois, il vous permet de décrypter l'actualité, de partager vos solutions de gestion et vous accompagne dans l'exercice de votre mandat. Son site Internet, mairesdefrance.com, vous permet d’accéder à toute l'information dont vous avez besoin, où vous voulez, quand vous voulez et sur le support de votre choix (ordinateur, tablette, smartphone, ...).