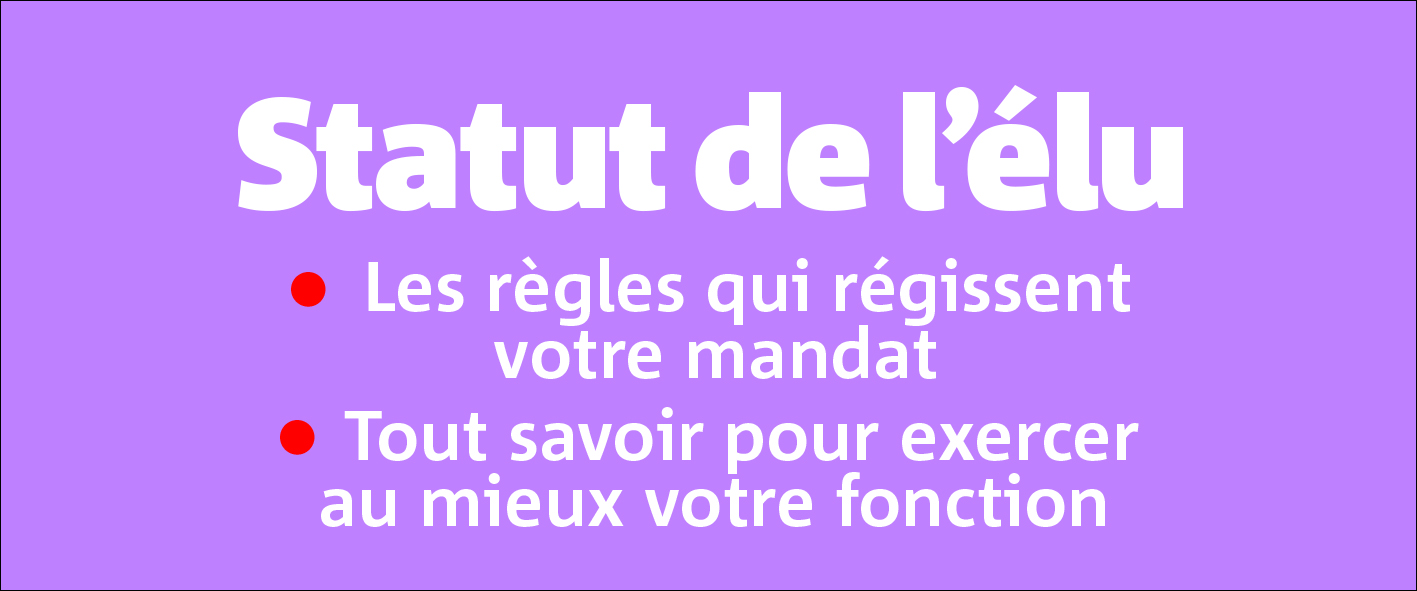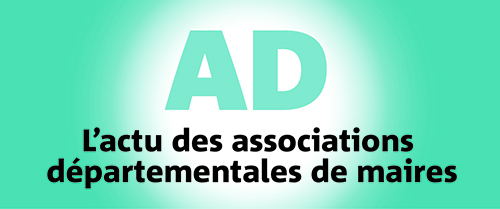01/01/1970
janvier 2020
- n°375
Écoles, éducation, alimentation
Le bio à la cantine nécessite de structurer des filières locales
Les collectivités ayant déjà atteint les 20 % de bio ont choisi une approche progressive. Elles insistent notamment sur la nécessité d'associer tous les acteurs à la démarche.
Emmanuel GUILLEMAIN D'ECHON

À Dolus-d'Oléron (17), la commune sert 50 % de bio dans les assiettes, surtout en local et de saison. C'est d'ailleurs un maraîcher bio qui fournit la cantine via sa ferme de La Poltière.
Dolus-d’Oléron : la ...
La suite de l'article est réservée aux abonnés...
Déjà abonné ? Se connecter
 Accédez à tous les contenus de Maires de France en illimité
Accédez à tous les contenus de Maires de France en illimité
 Bénéficiez d’une offre de référence éditée par l’AMF
Bénéficiez d’une offre de référence éditée par l’AMF
 Choisissez le tarif qui vous correspond
Choisissez le tarif qui vous correspond
La suite de l'article est réservée aux abonnés...
Déjà abonné ? Se connecter
 Accédez à tous les contenus de Maires de France en illimité
Accédez à tous les contenus de Maires de France en illimité
 Bénéficiez d’une offre de référence éditée par l’AMF
Bénéficiez d’une offre de référence éditée par l’AMF
 Choisissez le tarif qui vous correspond
Choisissez le tarif qui vous correspond
Cet article a été publié dans l'édition :
n°375 - janvier 2020
- Le bio à la cantine nécessite de structurer des filières locales
- Espaces de stationnement : à chacun sa place
- Réfugiés
- L'exercice de la compétence « politique locale de l'habitat »
- Diffamation, injures sur les réseaux sociaux : comment agir ?
- Mobilité en territoires peu denses : vers la fin des zones blanches ?
- Loi mobilités : une refonte de l'organisation territoriale d'ici 2021
- Quand les collectivités soutiennent les librairies
- Sallertaine structure un village d'artisans d'art
- Un tiers-lieu culturel doté d'une Micro-Folie
- Fin de mandat : ce que les élus doivent anticiper
- Élections : accompagner les personnes en situation de handicap
- De nouvelles clarifications du Code électoral
- Demandes d'autorisation d'exploitation commerciale : clarification sur la suspension de la procédure
- Fonction publique : mobilité et évolution professionnelle des agents
- Protéger les populations, un défi majeur face au risque nucléaire
- Violences à l'encontre des élus : vers une réponse pénale systématique ?
- Les priorités de la nouvelle Commission européenne
- « Il faut enfin donner du poids à la dimension territoriale »
- Le bistrot, premier lieu de lien social
- Piolenc crée une centrale photovoltaïque flottante
Les offres d’abonnement
Toutes les éditions
Maires de France est le magazine de référence des maires et élus locaux. Chaque mois, il vous permet de décrypter l'actualité, de partager vos solutions de gestion et vous accompagne dans l'exercice de votre mandat. Son site Internet, mairesdefrance.com, vous permet d’accéder à toute l'information dont vous avez besoin, où vous voulez, quand vous voulez et sur le support de votre choix (ordinateur, tablette, smartphone, ...).