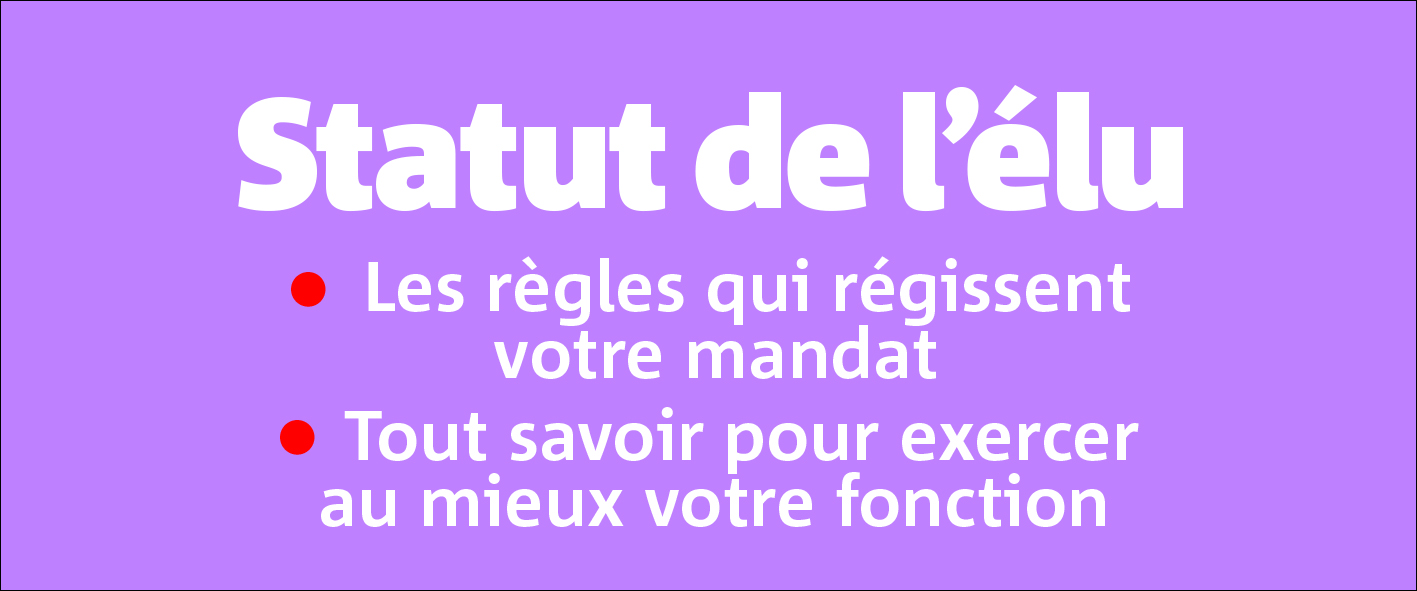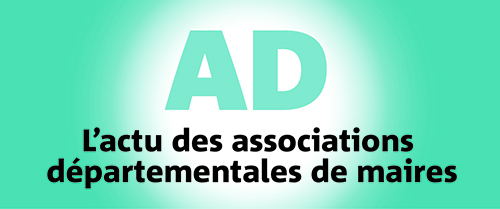01/01/1970
Avril 2019
- n°367
Aménagement, urbanisme, logement Social
Des modes de logement alternatifs pour les personnes âgées
Des petites collectivités bataillent pour offrir des solutions entre l'EHPAD et le maintien à domicile, permettant aux aînés de demeurer dans leur commune.
Sophie LE GALL

L'originalité de la Marpa de Souvigny-de-Touraine (37) est l'aspect intergénérationnel.
Les activités périscolaires sont consacrées aux jeux de société avec les résidents.
La suite de l'article est réservée aux abonnés...
Déjà abonné ? Se connecter
 Accédez à tous les contenus de Maires de France en illimité
Accédez à tous les contenus de Maires de France en illimité
 Bénéficiez d’une offre de référence éditée par l’AMF
Bénéficiez d’une offre de référence éditée par l’AMF
 Choisissez le tarif qui vous correspond
Choisissez le tarif qui vous correspond
Cet article a été publié dans l'édition :
n°367 - Avril 2019
- Loi Elan : décryptage du volet littoral
- Drones : ce que prévoit la réglementation
- Une cure d'austérité pour les nouveaux programmes des agences de l'eau
- La concertation, pierre angulaire des futurs Sraddet
- Savoir intégrer la santé dans les projets de la collectivité
- Favoriser une agriculture de proximité
- Jeunes migrants : Rezé se mobilise pour leur accueil
- Comment les réseaux sociaux transforment la relation maire-citoyen
- Gens du voyage : Un décret fixe les règles applicables aux aires de grand passage
- Les outils d'information et de participation des habitants
- Coup de pouce européen aux projets énergétiques
- Des modes de logement alternatifs pour les personnes âgées
- Forêt : la stratégie européenne va être revue
- Règlementer l'utilisation des engins de déplacement personnel (EDP)
- Eau : la mise en œuvre complexe de la Gemapi
- Gemapi : les gestionnaires confrontés à de nombreuses interrogations
- Isère : les intercommunalités confient la Gemapi à un syndicat
- Gens du voyage
- À Cliousclat, l'activité de poterie renaît
- Des chantiers propres et sécurisés
- Aides d'État et commande publique : vers un assouplissement des règles ?
- La Haute-Garonne ouvre son portail Open data
Les offres d’abonnement
Toutes les éditions
Maires de France est le magazine de référence des maires et élus locaux. Chaque mois, il vous permet de décrypter l'actualité, de partager vos solutions de gestion et vous accompagne dans l'exercice de votre mandat. Son site Internet, mairesdefrance.com, vous permet d’accéder à toute l'information dont vous avez besoin, où vous voulez, quand vous voulez et sur le support de votre choix (ordinateur, tablette, smartphone, ...).