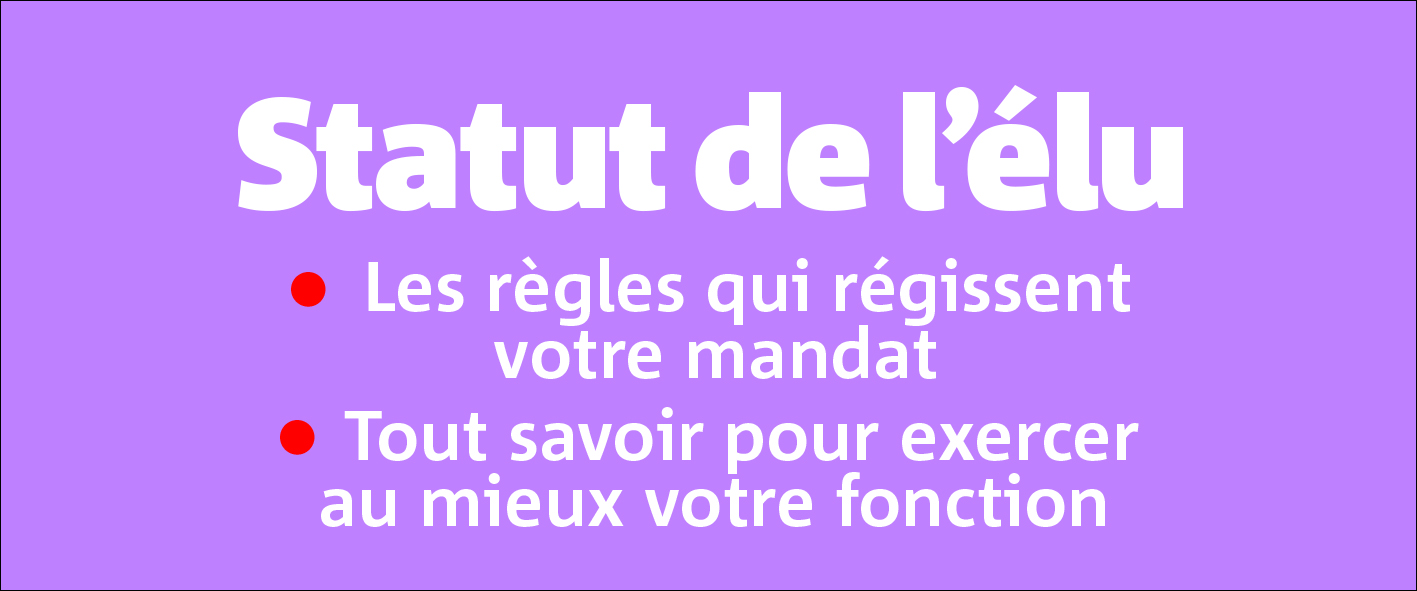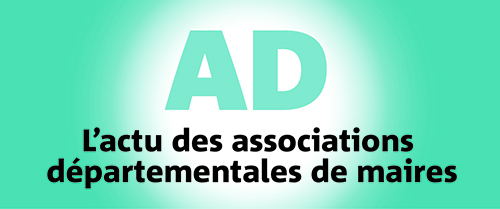01/01/1970
mars 2020
- n°377
Environnement
Partage de la nature : concilier tous les usages
Concilier les demandes et assurer la sécurité de tous les usagers des espaces ruraux relève parfois du casse-tête. Pour cela, les maires doivent user de diplomatie.
Sarah FINGER

© Mairie de Balbigny
La commune de Balbigny (42) a élaboré avec le Syndicat mixte de la retenue du barrage de Villerest un
circuit de grande randonnée pédestre impliquant randon-neurs, chasseurs, pêcheurs...
Ce fut le cas à Ballancourt-sur-Essonne (7 500 hab.). Informé des tensions, des inquiétudes et des incidents qui intervenaient sur les espaces naturels de sa commune, Jacques Mione, le maire, a décidé de mettre tout le monde autour d’une même table. Il raconte : «Les affûts installés par les chasseurs le long des chemins de randonnée provoquaient à la fois crainte et incompréhension. Nous avions aussi eu écho que des clous avaient été placés sur des sentiers utilisés par des VTT… » Bref, Jacques Mione a estimé qu’il était grand temps de ramener un peu de sérénité. « J’ai ...
La suite de l'article est réservée aux abonnés...
Déjà abonné ? Se connecter
 Accédez à tous les contenus de Maires de France en illimité
Accédez à tous les contenus de Maires de France en illimité
 Bénéficiez d’une offre de référence éditée par l’AMF
Bénéficiez d’une offre de référence éditée par l’AMF
 Choisissez le tarif qui vous correspond
Choisissez le tarif qui vous correspond
Cet article a été publié dans l'édition :
n°377 - mars 2020
- Maire et secrétaire de mairie, un tandem indispensable à préserver
- Sonorisation : maîtriser les décibels
- Sobriété foncière : l'AMF prône une approche différenciée
- Loi "engagement et proximité" : les mesures relatives à l'urbanisme
- Ardèche : les élus mobilisés pour le retour des trains de voyageurs
- Agir en faveur du vélo dans une petite ville
- Transports. Accélérer la mise en œuvre du plan de sécurisation des passages à niveaux
- Quand une bibliothèque intègre le « Facile à lire »
- Engager une action globale pour la santé
- Municipales : le déroulement des opérations électorales
- L'installation des nouvelles instances intercommunales et syndicales
- Vieillissement : repenser la prise en charge des plus âgés
- Fonction publique : gestion de l'inaptitude et du handicap
- Fonction publique : les mesures renforçant l'égalité femmes-hommes
- Le recours aux fonctionnaires territoriaux à temps non complet
- Les maires prennent leur place au sein du Comité des régions
- Quand les DAD se rendent à Bruxelles
- Brexit : et maintenant ?
- Élections. Circulaire « nuançage » : nouvelle mouture après la décision du Conseil d'État
- Loi anti-gaspillage et économie circulaire : principales mesures
- Partage de la nature : concilier tous les usages
- Les communes face au défi de leur transition énergétique
- Pesticides : mise en œuvre des chartes locales
Les offres d’abonnement
Toutes les éditions
Maires de France est le magazine de référence des maires et élus locaux. Chaque mois, il vous permet de décrypter l'actualité, de partager vos solutions de gestion et vous accompagne dans l'exercice de votre mandat. Son site Internet, mairesdefrance.com, vous permet d’accéder à toute l'information dont vous avez besoin, où vous voulez, quand vous voulez et sur le support de votre choix (ordinateur, tablette, smartphone, ...).