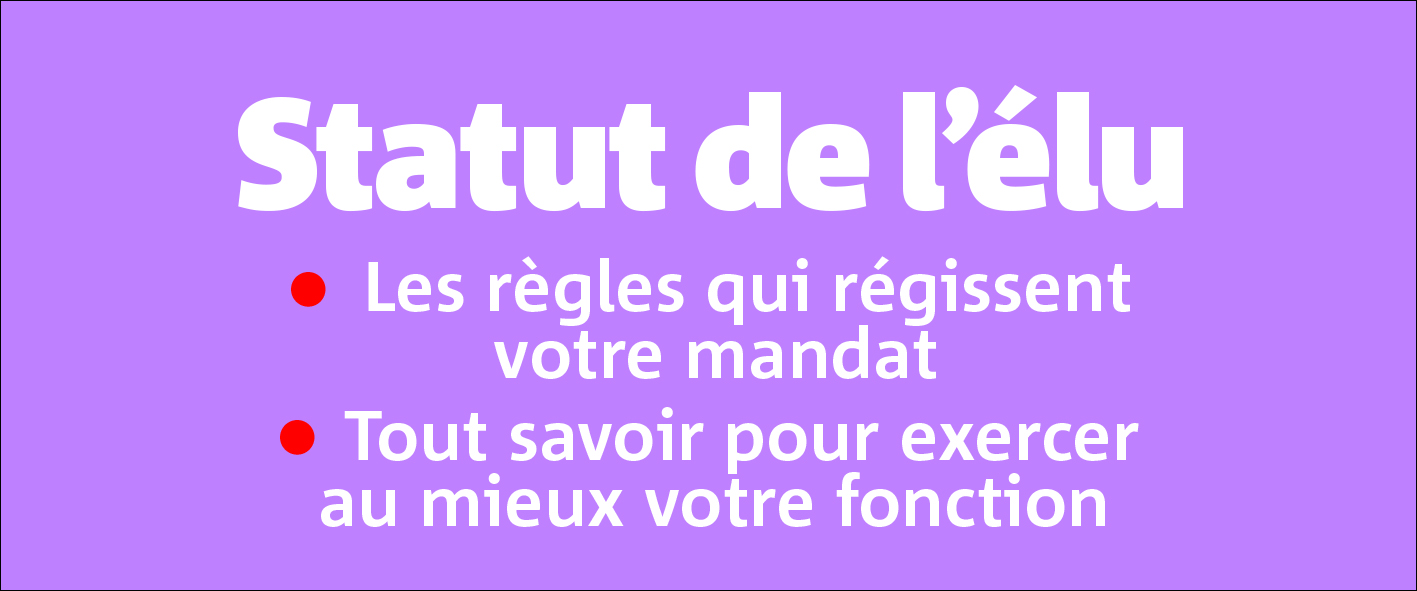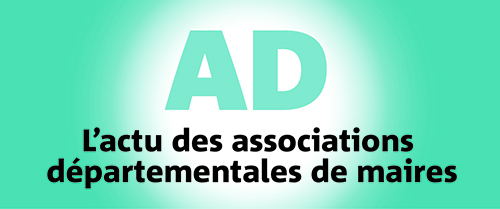01/01/1970
Février 2019
- n°365
Sécurité - sécurité civile Social
Intégrer des réfugiés requiert une action dans la durée
L'État s'appuie sur les collectivités pour l'accueil et l'intégration des réfugiés. Les premiers contrats territoriaux devraient être signés début 2019.
Emmanuelle STROESSER

© Rémy Lehmann/mairie de Thal-Marmoutier
La suite de l'article est réservée aux abonnés...
Déjà abonné ? Se connecter
 Accédez à tous les contenus de Maires de France en illimité
Accédez à tous les contenus de Maires de France en illimité
 Bénéficiez d’une offre de référence éditée par l’AMF
Bénéficiez d’une offre de référence éditée par l’AMF
 Choisissez le tarif qui vous correspond
Choisissez le tarif qui vous correspond
Cet article a été publié dans l'édition :
n°365 - Février 2019
- Pour les entreprises, la région n'est pas encore le bon échelon
- Tourisme
- Logement social : bâtir un cadre juridique adapté
- La Haute-Garonne reprend la gestion de stations de ski
- Un décret institue les comités de suivi des dessertes ferroviaires
- Véhicules électriques : des offres satisfaisantes
- RescUE, le renfort européen en cas de catastrophes naturelles
- Prévenir la radicalisation violente
- Carrières et rémunérations : les mesures de PPCR applicables en 2019
- Un arrêté fixe le cadre pour limiter l'éclairage
- Gemapi : les missions d'appui technique maintenues jusqu'en 2020
- Mobilité douce : favoriser la marche à pied en ville
- L'organisation de manifestations sportives non motorisées
- Mane réhabilite ses bâtiments dégradés
- Loi Élan : décryptage du volet "aménagement"
- Intégrer des réfugiés requiert une action dans la durée
- Gens du voyage : la Seine-et-Marne se dote d'un GIP
- Emploi : les collectivités sont sur tous les fronts
- Comment utiliser la convention de gestion entre communes et EPCI ?
- Consultations citoyennes : les Français oscillent entre espoir et frustration
- Près de 800 communes nouvelles ont été créées
- Tout savoir sur la réforme de la taxe de séjour en 2019
- La constitution d'une "police intercommunale" peut-elle être envisagée au titre d'une compétence facultative d'un établissement public de coopération intercommunale ?
Les offres d’abonnement
Toutes les éditions
Maires de France est le magazine de référence des maires et élus locaux. Chaque mois, il vous permet de décrypter l'actualité, de partager vos solutions de gestion et vous accompagne dans l'exercice de votre mandat. Son site Internet, mairesdefrance.com, vous permet d’accéder à toute l'information dont vous avez besoin, où vous voulez, quand vous voulez et sur le support de votre choix (ordinateur, tablette, smartphone, ...).