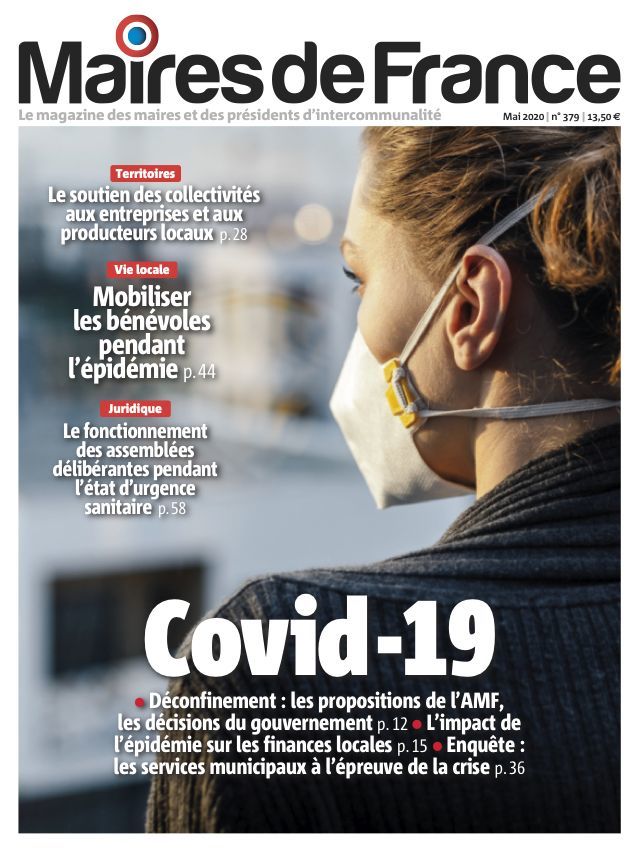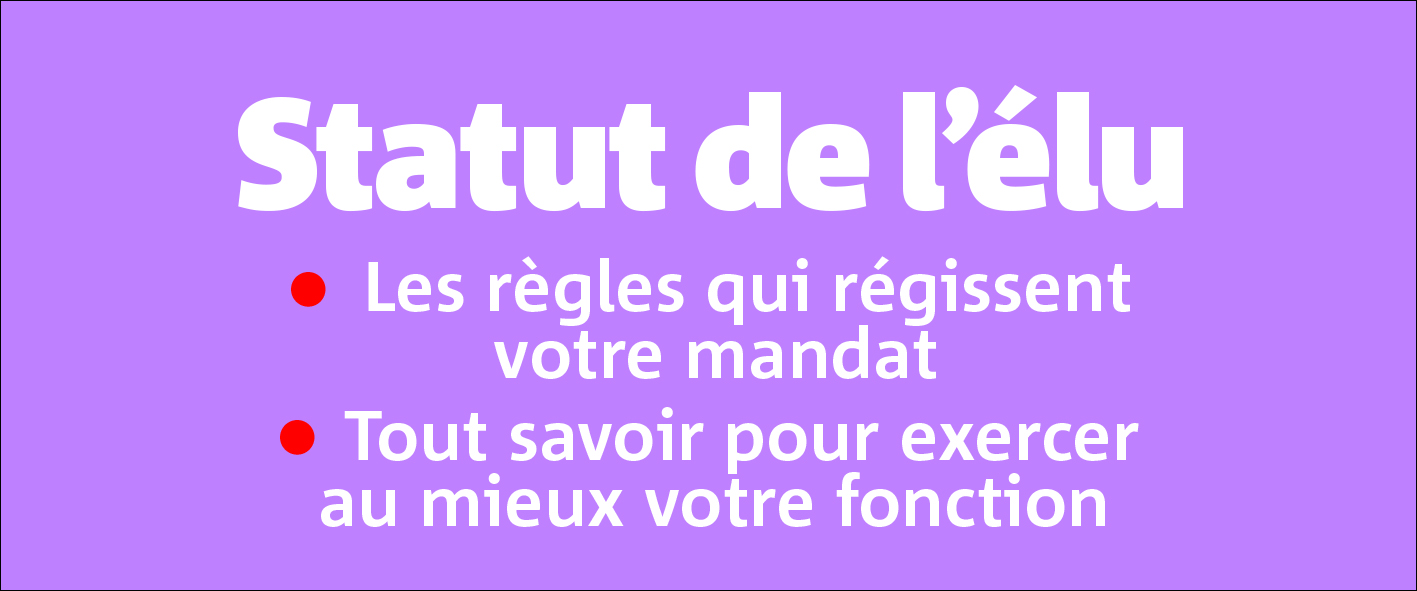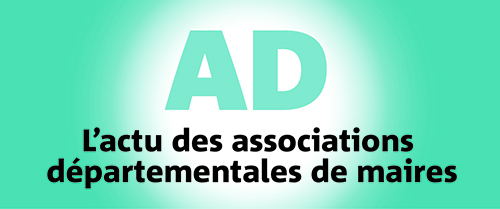01/05/2020
mai 2020
- n°379
Social
Gérer le bénévolat spontané en temps de crise
Afin de soutenir les « Je veux aider ! » de leurs habitants, les communes sont parvenues à poser dans l'urgence un cadre sécurisant pour les aidants comme pour les aidés.

© Pascal Bachelet/BSIP VIA AFP
Quelles que soient les missions exercées par les bénévoles (livraison de médicaments, lien social avec les personnes isolées...), les communes leur rappellent le respect des gestes barrières et leur fournissent, selon leurs ressources, gel, masques et gants.
Fixer ...
La suite de l'article est réservée aux abonnés...
Déjà abonné ? Se connecter
 Accédez à tous les contenus de Maires de France en illimité
Accédez à tous les contenus de Maires de France en illimité
 Bénéficiez d’une offre de référence éditée par l’AMF
Bénéficiez d’une offre de référence éditée par l’AMF
 Choisissez le tarif qui vous correspond
Choisissez le tarif qui vous correspond
La suite de l'article est réservée aux abonnés...
Déjà abonné ? Se connecter
 Accédez à tous les contenus de Maires de France en illimité
Accédez à tous les contenus de Maires de France en illimité
 Bénéficiez d’une offre de référence éditée par l’AMF
Bénéficiez d’une offre de référence éditée par l’AMF
 Choisissez le tarif qui vous correspond
Choisissez le tarif qui vous correspond
Cet article a été publié dans l'édition :
n°379 - mai 2020
- Propreté des espaces publics : adapter les moyens
- Covid-19 : les mesures transitoires concernant la gestion locale
- Les travaux d'amélioration éligibles au dispositif Denormandie sont élargis
- Développer le numérique au service des habitants
- Les services municipaux à l'épreuve de la crise
- Des précisions (mais incomplètes) sur les modalités du subventionnement par l'ANS
- Les nouvelles mesures renforçant les pouvoirs de police du maire
- Covid-19 : les collectivités au chevet des entreprises
- Les maires aident le commerce local et les agriculteurs
- Gérer le bénévolat spontané en temps de crise
- Les conditions de mise en œuvre d'un couvre-feu par le maire
- Certains délais administratifs qui avaient été suspendus sont « dégelés »
- Renforcer la sécurité des agriculteurs
Les offres d’abonnement
Toutes les éditions
Maires de France est le magazine de référence des maires et élus locaux. Chaque mois, il vous permet de décrypter l'actualité, de partager vos solutions de gestion et vous accompagne dans l'exercice de votre mandat. Son site Internet, mairesdefrance.com, vous permet d’accéder à toute l'information dont vous avez besoin, où vous voulez, quand vous voulez et sur le support de votre choix (ordinateur, tablette, smartphone, ...).